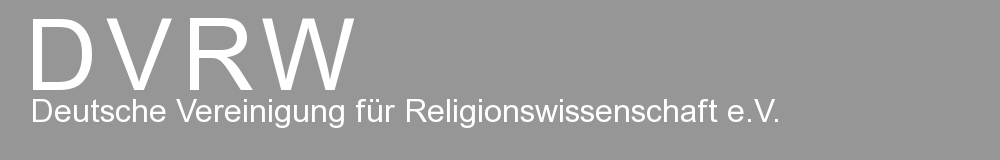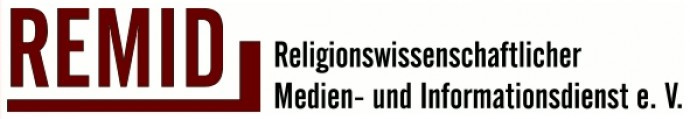The early days of French sociology of religion
Ecartant l'idée selon laquelle la sociologie religieuse ne commence en France qu'avec les enquêtes de pratique religieuse dans les années trente, l'auteur entreprend d'illustrer la filiation des courants actuels de recherche explorés par les sociologues français.Pour qu'une...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Electronic Article |
| Language: | English |
| Check availability: | HBZ Gateway |
| Interlibrary Loan: | Interlibrary Loan for the Fachinformationsdienste (Specialized Information Services in Germany) |
| Published: |
[1969]
|
| In: |
Social compass
Year: 1969, Volume: 16, Issue: 4, Pages: 435-452 |
| Online Access: |
Volltext (Resolving-System) Volltext (doi) |
| Summary: | Ecartant l'idée selon laquelle la sociologie religieuse ne commence en France qu'avec les enquêtes de pratique religieuse dans les années trente, l'auteur entreprend d'illustrer la filiation des courants actuels de recherche explorés par les sociologues français.Pour qu'une sociologie religieuse fût possible, il a fallu que les sciences humaines se voient reconnues, que la sociologie se pose comme science et qu'on admette de voir la religion examinée par une science profane. L'auteur montre ce que ces acquisitions doivent au 'siècle des Lumières' avec Montesquieu, Rousseau et les Encyclopédistes et en particulier avec des hommes comme le Président des Brosses ou B. Constant. L'apport du 19eme siècle aussi est fondamental dans la constitution d'une science des sociétés. Saint Simon, avec le Nouveau Christianisme, ouvre la voie à Buchez et surtout Auguste Comte.Parallèlement, avec des chercheurs comme Le Play s'ouvre la voie des monographies de familles ou de villages, pour l'étude du facteur reli gieux. Avec Malte-Brun, Fournier de Flaix, le Comte d'Angeville la recherche s'oriente vers la statistique de l'appartenance religieuse et des cultes.Mais la sociologie 'classique' trouve sa référence principale en France dans les oeuvres de Durkheim et son école ainsi que dans les recherches de Lévy-Bruhl. Les travaux de Durkheim comme Les formes élémentaires de la vie religieuse ou Le suicide fournissent un apport capital à l'étude des contenus religieux et marquent profondément l'école française de sociologie religieuse dans son goût pour la positivité, l'objectivité et la méthode qualitative. Les pistes ouvertes par Lévy-Bruhl et après lui par R. Hubert et M. Mauss en ethnologie continuent d'être explorées dans l'étude de la religion vécue. |
|---|---|
| ISSN: | 1461-7404 |
| Contains: | Enthalten in: Social compass
|
| Persistent identifiers: | DOI: 10.1177/003776866901600402 |